Floriant Covelli, Délégué Général de l’Institut français du Monde associatif intervenait ce jour dans un séminaire du CENTRE FRANCAIS DES FONDATIONS intitulé « Proximités fertiles : agissons avec les associations et les habitants ». Il y a partagé plusieurs réflexions issues des travaux de l’Institut, dont voici quelques éléments de synthèse.
Que peut-on dire des concepts de proximité et de territoires au regard de l’action des associations et de la philanthropie ?
Les crises multiples que traverse la société (crise financière, crise climatique, crise sanitaire, crise démocratique, guerre à nos frontières, …) réhabilitent le concept de proximité comme point d’entrée dans la recherche de solutions à des problèmes globaux.
L’urgence des crises ouvre des perspectives pour une nouvelle articulation territoriale entre action publique, action collective citoyenne et philanthropie. La philanthropie stratégique, qui se donne pour objectif de faire levier sur les politiques publiques, aura ici une place à prendre.
Dans ce contexte, on peut se demander si les associations sont porteuses de nouveaux récits de territoires (territoires solidaires, accueillants, résilients, apprenants, zéro chômeurs, …). La notion de récit de territoire est d’intérêt, tant par sa capacité à révéler la valeur sociétale créée par les associations à l’échelon local, que par sa portée culturelle fédératrice et transformatrice.
Ce contexte est propice également à un changement de paradigme dans notre perception des territoires. Longtemps calqués dans nos perception sur les champs de compétences des collectivités territoriales, financements obligent, comment dépasser la vision de territoires comme simples espaces administrés par la puissance publique ? Comprendre les territoires comme des territoires de liens, des écosystèmes vivants, c’est-à-dire des construits sociaux, nous semble ouvrir une nouvelle voie d’analyse. Pour comprendre les territoires sous le prisme des interactions entre les acteurs. Et pour comprendre la place que les associations, en partie reliées à la philanthropie, jouent dans la fabrique du territoire. Pour la philanthropie, ce sera une voie pour mieux comprendre sa contribution locale aux « changement écosystémiques ».
Autour de quoi s’organisent aujourd’hui les relations entre fondations et associations ?
L’analyse des relations entre associations et fondations nécessite de s’intéresser à la place que la générosité privée prend dans les modèles socio-économiques associatifs. Ce qui impliquera d’analyser, au-delà des chiffres (à ce sujet voir Le Paysage associatif français, Viviane Tchernonog, 2019), la nature de ce qui est financé par la philanthropie, et notamment son appui à la fonction socio-politique des associations (innovation, interpellation, lien social) et à la dimension collective citoyenne de leurs projets. Cette analyse devra laisser une place également aux soutiens extra-financiers apportés par les fondations, tant en termes d’expertise que de réseau. Elle devra également intégrer l’évaluation comme un marqueur des relations entre fondations et associations (pourquoi évalue-t-on ? Qu’évalue-t-on ? Comment évalue-t-on ?) et comme source d’influence des pratiques associatives, notamment à travers le prisme de la mesure d’impact.
Quelle articulation entre fondations, associations et habitants, et quels enjeux démocratiques ?
Un premier élément marquant de cette articulation est le pouvoir d’agir des habitants, au cœur des stratégies de financement des associations par de nombreuses fondations. Cela rejoint l’appui des fondations au rôle d’expertise citoyenne des associations et à leur fonction socio-politique.
La notion de confiance est un autre trait commun qui relie associations, fondations et habitants. Les associations sont plébiscitées dans les sondages comme institutions de confiance préférées des français, tandis que la philanthropie et le don reposent eux aussi sur la confiance.
A l’heure où la crise démocratique est une crise de confiance, il y a là un sujet important à analyser pour comprendre comment l’action articulée des fondations, des associations et des habitants peut être un levier de résilience démocratique.
L’appui à la fonction socio-politique associative, autrement dit au rôle de « corps intermédiaire » des associations, ou encore l’enjeu démocratique associatif, est pourtant encore très peu affiché comme une ambition par les fondations françaises. Comparativement, le terrain international ouvre d’autres perspectives : les Bürger Stiftung en Allemagne (littéralement « fondations de citoyens »), les community foundations engagées dans la capacitation citoyenne dans les pays de l’Est, ou encore le mouvement anglo-saxon de grass roots philanthropy adossé à un projet de démocratie participative à l’échelon local.
La philanthropie territoriale française pourrait s’emparer de ces enjeux, en ne considérant pas simplement les habitants comme bénéficiaires ou acteurs des projets soutenus, mais en leur laissant également une place dans les dispositifs d’expertise et de gouvernance philanthropiques eux-mêmes. Les Civic Tech pourraient également être mobilisées par la philanthropie pour consulter ou associer les habitants à leurs processus de décisions.

Floriant Covelli
Délégué général, Institut français du Monde associatif
Institut français du Monde associatif
1 Rue Dr Fleury Pierre Papillon, 69100 Villeurbanne

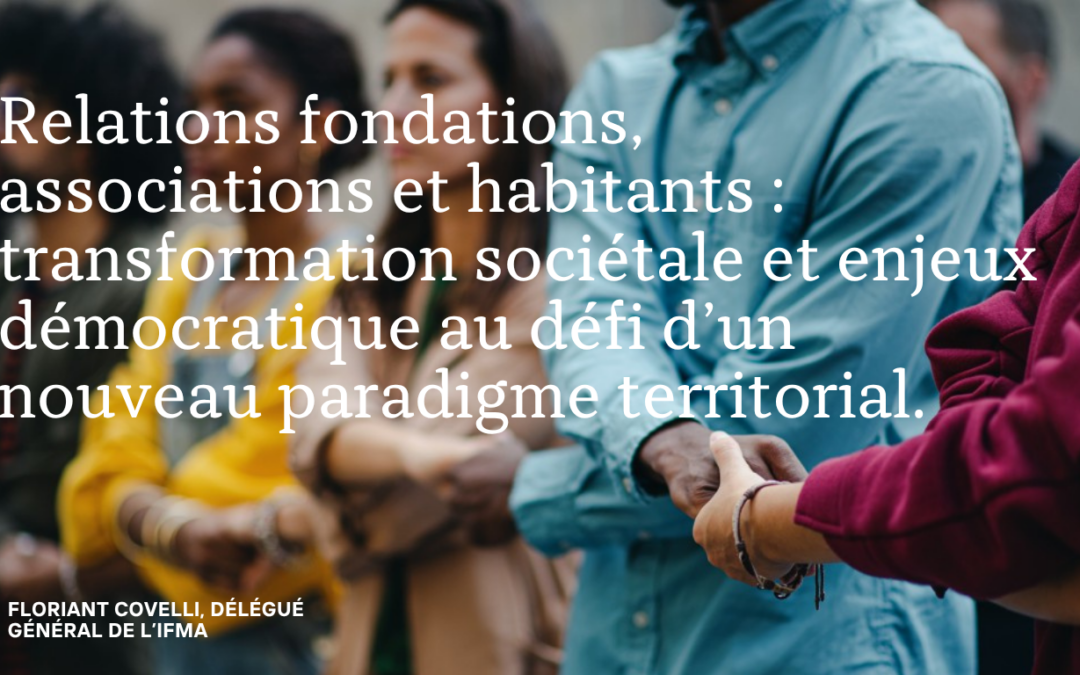
Commentaires récents