Projet lauréat
Mise en mots et mise en récit du quotidien comme mode d’engagement à l’échelle du territoire
Appel à projets : quelle contribution des associations aux territoires ?
Dates du projet : septembre 2024 – décembre 2025
Mots clés : permanence de recherche, écritures impliquées, mise en récit, collectif
Le projet vise à interroger la mise en mots et en récit des expériences associatives qui se développent dans les quartiers populaires au travers de “permanences de recherche” qui associent chercheur·es, professionnel·les, usager·ères et acteur·ices de ces structures. Il s’agit pour nous de partir de deux lieux (ineter)associatif, le Polyblosne à Rennes et le Centre socioculturel coopératif “Le 110” à Saint-Denis en y développant notre recherche participative. Depuis ces deux espaces, nous tentons d’engager collectivement des formes d’écritures et de publications autonomes pour restituer et donner à voir les expériences, le quotidien, le territoire, afin de mieux agir dessus.
Quel apport du projet au monde associatif et à ses partenaires ?
Dans le cadre de notre projet, nous tentons d’apporter deux contributions qui nous semblent particulièrement importantes pour le monde associatif et ses partenaires:
– À travers nos “permanences de recherche” nous tentons de réfléchir aux enjeux de la corecherche pour accompagner, densifier, problématiser et “agir” (sur) les expériences associatives au quotidien. Il s’agit ici de penser la recherche-action comme un « équipement démocratique » contribuant à des dynamiques émancipatrices (capacitation citoyenne, pouvoir d’agir, expérimentation par le bas, tentatives autonomes). Notre conception de la recherche-action en tant qu’équipement démocratique rejoint l’hypothèse défendue par Yves Citton [« Post-scriptum sur les sociétés de recherche-création », in Erin Manning & Brian Massumi, Pensée en acte (Vingt propositions pour la recherche-création), Les Presses du réel, 2018] quand il théorise le fait que la recherche-action / recherche-création pourrait contribuer à l’émergence d’un nouveau mode de « gouvernementalité » dans (de) nos villes, nos « lieux » de vie ou nos quartiers, à travers une nouvelle manière d’administrer les affaires communes qui intègre l’inattendu comme ressource (pour penser et créer), le processus comme expérience du temps riche de la diversité de ses rythmes, de ses durées ou de ses événements, la délibération pour, sans relâche, interpréter en commun la complexité inévitable, et désirable, du réel.
– Notre seconde contribution porte plus spécifiquement sur les pratiques d’écriture. Les écritures du monde associatif nous semblent grandement appauvries par les formes instituées et envahissantes des appels à projet, rapports d’activité, mail… À cet endroit, il nous semble nécessaire que le monde associatif se réapproprie des formes d’écritures plus réflexives et créatives à même de rendre compte de la densité et de la richesse des expérimentations qui trament le quotidien de leur territoire d’intervention. L’apport de notre projet au monde associatif se situe donc dans ce renouveau des écritures associatives qui, nous semble-t-il, doivent assumer, au quotidien, des formes de caractérisation plus importante, de problématisation plus systématique, mais aussi de créativité plus assumée.
Innovation pour la connaissance
Les deux contributions que nous avons détaillées ci-dessus recoupent deux enjeux actuels en sciences sociales :
– Notre travail sur la recherche-action et le dispositif des « permanences de recherche » que nous développons au sein des structures associatives de proximités entre pleinement dans le dialogue sciences, recherche et société. En 2021 la loi de programmation de la recherche « science avec et pour la société » présentait une feuille de route dont l’ambition affichée se concentrait sur le double enjeu de : « nourrir le débat démocratique et appuyer les décisions publiques et permettre à chacun de comprendre le monde qui l’entoure et d’y prendre part. ». Dans cette perspective, nous pensons nécessaire que les chercheur·es développent leur travail dans la durée, par une présence suivie, en coopération avec les actrices et acteurs du monde associatif afin de se familiariser avec leur expérience. Ainsi, dans le cadre des permanences de recherche, les chercheur·es impulsent des démarches de recherche en faisant expérience avec les personnes et en partageant, autant que possible, leurs activités.
– Dès lors que les chercheurs sont invités à réengager leurs pratiques avec les premier·ères concernées, les formes et modes d’écriture des expériences de recherche sont (re)mises en question. Ces dimensions rejoignent un axe de recherche structurant de notre laboratoire (LIAgE, anciennement EXPERICE) sur la question des « écritures impliquées ». Ce projet contribue aussi à la réflexion contemporaine autour des communs urbains et des communs de la connaissance, qui sont au cœur des travaux de notre équipe « Territoires en expérience(s) ». Il s’agit en effet, grâce à la mise en récit et en écriture de la vie quotidienne au sein des territoires, de favoriser une interconnaissance des interventions et actions, un partage de savoirs et une mutualisation des expériences, conditions pour tenter de faire vivre des dimensions de « commun » à l’échelle d’un territoire.
Présentation de l’équipe

Louis Staritzky
Docteur en sociologie, Université Paris 8, Laboratoire LIAgE

Benjamin Roux
Chercheur indépendant, éditeur (Édition du Commun)

Pascal Nicolas-Le Strat
Enseignant-chercheur, Université Paris 8, Laboratoire LIAgE
Nous remercions nos partenaires pour leur soutien

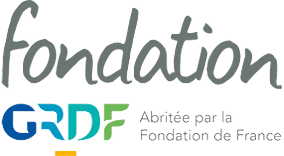


Institut français du Monde associatif
1 Rue Dr Fleury Pierre Papillon, 69100 Villeurbanne
